La parabole du riche et de Lazare
Publié par Valentin le
La parabole du riche et de Lazare
Dans l’Évangile de Luc, il apparaît un récit aussi perturbant qu’énigmatique : la parabole du riche et de Lazare. En effet, à travers le récit de deux protagonistes diamétralement opposés, Jésus explique comment l’utilisation des biens terrestres et la responsabilité morale envers autrui se répercuteront éternellement.
Comment comprendre cette parabole ? Les riches sont-ils condamnés à l’enfer ? Comment doit-on considérer l’utilisation des richesses ?
Cet article analysera la parabole, explorera les diverses interprétations et mettra en lumière les enseignements qui en découlent.
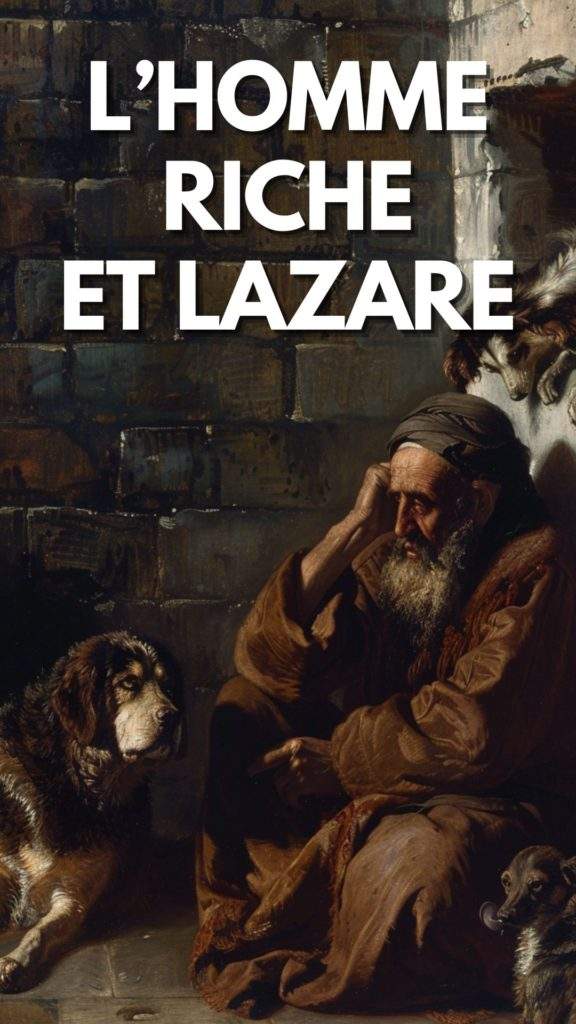
Table des matières
#1 La parabole (Luc 16 : 19-31)
19 « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux.
20 Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères.
21 Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères.
22 Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra.
23 Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui.
24 Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise.
25 – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance.
26 Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.”
27 Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père.
28 En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !”
29 Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent !
30 – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.”
31 Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »
#2 Le contexte
Avant d’analyser cette parabole, il est essentiel d’en comprendre le contexte. Cette section se focalisera spécifiquement sur le sujet des finances dans l’Évangile de Luc et explorera le contexte du chapitre concerné.
A. L'évangile de Luc
- Un Évangile qui traite abondamment de l’argent et des richesses
L’argent et les possessions matérielles sont des sujets récurrents dans les écrits de Luc, tant dans son Évangile que dans les Actes des Apôtres. Plusieurs passages mettent en lumière les dangers des richesses, soulignent les devoirs des fidèles envers les démunis, ou appellent à une gestion des biens terrestres orientée vers l’expansion du Royaume de Dieu.
Cette préoccupation est illustrée à travers diverses paraboles dans l’Évangile de Luc, telles que celles des talents, du riche insensé, de l’économe infidèle ou encore du riche et de Lazare.
Pourquoi une telle emphase sur les richesses ?
Trois raisons pourraient justifier l’accent mis sur l’argent dans l’Évangile de Luc.
Raison n°1 : les écrits de Luc étaient destinés à une personne fortunée.
L’Évangile de Luc et les Actes étaient adressés à Théophile :
Il m’a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d’une manière suivie, excellent Théophile,
Luc 1 : 3
Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner dès le commencement
Actes 1 : 1
Le terme « excellent » met en évidence un statut d’autorité dans le gouvernement romain. Le même titre est d’ailleurs retrouvé pour désigner les magistrats romains Félix (Actes 23 :26) et Festus (Actes 26 :25).
Ainsi, les exégètes estiment que Théophile était probablement une personne de haut rang social, récemment convertie et nécessitant une assise solide dans la foi. De ce fait, il n’est pas surprenant que Luc insiste sur le thème des biens matériels dans ses écrits.
Raison n° 2 : Luc était vraisemblablement riche
Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas.
Colossiens 4 : 14
Une autre raison qui pourrait expliquer l’omniprésence de l’argent dans les écrits de Luc viendrait de son statut social. En se basant sur sa profession de médecin, son niveau d’éducation ainsi que ses relations, il est envisageable de penser que Luc faisait partie de la classe aisée.
Par conséquent, il est probable que la gestion d’un patrimoine et les risques liés à la richesse étaient des thèmes qu’il avait étudiés en profondeur, dont il était conscient et qu’il considérait comme importants.
Raison n°3 : l’argent est un marqueur important de la relation du croyant avec Dieu
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur.
Luc 12 : 34
La fréquence du thème de l’argent dans l’Évangile de Luc pourrait également s’expliquer par l’importance que Jésus accordait à cette question. La relation d’une personne avec les biens matériels et la richesse peut être considérée comme un indicateur important de sa relation avec Dieu : elle peut soit succomber à leur attrait, soit les mettre au service du Royaume.
Luc rapporte ainsi les nombreux enseignements de Jésus concernant ce sujet.

B. Le contexte de la parabole
Le seizième chapitre de l’Évangile selon Luc contient deux paraboles : celle de l’économe infidèle, suivie de celle du riche et de Lazare, qui sont intimement connectés. Le contraste entre les actions l’économe infidèle est celles de l’homme riche est frappant : alors que l’un gère mal ses richesses, l’autre les utilise judicieusement.
Ce passage se situe alors que Jésus est en route vers Jérusalem. L’audience de Jésus semble être composée des disciples (Luc 16:1), mais également de pharisiens, comme le montrent les versets précédant la parabole du riche et de Lazare, où Jésus leur reproche notamment de vouloir plaire aux hommes, plutôt qu’à Dieu.
En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l’argent se moquaient de lui.
Luc 16 : 14
#3 Analyse de la parabole
A. Une parabole remplie de contrastes
Cette parabole se distingue par ses dualités frappantes qui transparaissent tout au long du récit. On peut citer :
- Un riche vivant dans le luxe et un pauvre, Lazare, vivant dans le besoin.
- Lazare est nommé tandis que le riche reste sans nom.
- Le riche, qui avait tout pour lui sur terre, finit par souffrir après la mort, alors que Lazare, qui n’avait rien, est finalement récompensé.
- Une porte séparait les deux protagonistes sur terre, symbolisant la chance manquée d’aider Lazare, mais après la mort, cette séparation devient définitive et impossible à franchir.
Dans le royaume de Dieu, les rôles s’inversent : les premiers deviennent les derniers, et une nouvelle forme de justice remplace celle connue sur terre.
B. Est-ce vraiment une parabole
Une minorité de commentateurs conçoit l’épisode du riche et de Lazare non pas comme une parabole, mais comme un événement réel. Cette interprétation est notamment défendue par l’utilisation d’éléments singuliers par Jésus, tels que l’emploi de noms propres ou l’absence d’une leçon de morale claire.
Néanmoins, l’idée qu’il s’agisse d’une parabole paraît plus plausible pour les raisons suivantes :
- Ce passage est compris dans une série de paraboles.
- Luc utilise l’expression introductive « un certain homme » (anthrōpos tis), la même qu’il emploie pour débuter plusieurs autres paraboles dans son Évangile.
- La description n’est pas cohérente avec la vision des autres textes quant au paradis ou à l’enfer, ce qui suggère que ce n’est pas une description littérale de ces lieux.
- Le nom Lazare était commun parmi les Israélites, avec onze personnes portant ce nom dans la Bible.
C. Les protagonistes
1. L’homme riche
L’homme riche dans cette parabole reste anonyme, Jésus pointant avant tout sa richesse comme caractéristique marquante.
Il est identifié comme juif, car il appelle Abraham « Père », et celui-ci lui répond « Mon fils ». Cette identité religieuse est consolidée au verset 29 où il est demandé à ses cinq frères de suivre « Moïse et les prophètes », c’est-à-dire les Écritures hébraïques.
Il était probablement un citoyen éminent, les textes bibliques associant souvent le lin et la pourpre à la richesse et à l’autorité. Le violet était, en effet, rare et cher en raison du processus difficile de teinture.
Le poids des anneaux d’or que demanda Gédéon fut de près de 20 kilos, et ce sans compter les ornements en forme de croissant, les boucles d’oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, ni les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux.
Juges 8 : 26
L’homme riche était également certainement considéré comme béni par Dieu, car à cette époque, la prospérité matérielle était interprétée par les Israélites comme une marque de la faveur divine.
Les raisons de sa damnation restent floues ; il n’est pas accusé de péchés majeurs, ni d’avoir mal agi envers Lazare. Jésus ne le décrit pas comme intrinsèquement mauvais. Néanmoins, sa gestion des richesses et son indifférence envers les autres semblent être la cause de sa condamnation.
Par ailleurs, même souffrant en enfer, il persiste à voir Lazare comme un serviteur inférieur, lui réclamant de l’eau au verset 24 et lui demandant de prévenir ses frères au verset 25, révélant un manque de repentance véritable.
2. Lazare
Contrairement à la vie agréable de l’homme riche, Lazare est un personnage confronté à d’importantes épreuves terrestres. Il est couvert de plaies, mendie et se nourrit des miettes. De plus, des chiens viennent lécher ses plaies, un détail crucial qui, d’après certains théologiens, lui attribue un statut d’impureté.
Tout au long de la parabole, Lazare reste passif : il ne prononce pas un mot et n’agit pas. Seul son désir de se nourrir est mentionné.
Toutefois, il n’est pas un personnage secondaire, car il est le seul protagoniste, avec Abraham, à être nommément identifié parmi toutes les paraboles de Jésus.
Il se pourrait que Jésus l’ait nommé pour ajouter une information supplémentaire à son personnage. En effet, « Lazare », dérivé d’« Eliezer », signifie « Dieu aide ». Ce nom souligne que, contrairement aux apparences de sa misère qui pouvaient laisser croire à une malédiction, Dieu était en réalité avec Lazare.
Après sa mort, il est emporté par les anges dans le « sein d’Abraham », un lieu de réconfort et d’honneur, possiblement le banquet eschatologique présenté en Luc 13 :
« C’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. On viendra de l’est et de l’ouest, du nord et du sud, et l’on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d’autres parmi les premiers seront les derniers. »
Luc 13 : 28-30

3. Abraham
La présence d’Abraham dans la parabole était vraisemblablement un moyen pour Jésus d’illustrer la notion du « sein d’Abraham », un lieu de réconfort et d’honneur, possiblement le banquet eschatologique mentionné dans Luc 13.
« C’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. On viendra de l’est et de l’ouest, du nord et du sud, et l’on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d’autres parmi les premiers seront les derniers. »
Luc 13 : 28-30
Par ailleurs, Abraham, considéré comme le père de la foi par les juifs et les chrétiens, est utilisé comme figure d’autorité dans cette parabole. Il n’est pas seulement une figure de réconfort pour Lazare, mais aussi un messager de la vérité divine.
En effet, il rejette les deux demandes de l’homme riche, qui sont de lui apporter de l’eau et d’avertir ses cinq frères, et lui explique les raisons de cette décision. Il fonctionne comme un guide moral pour le lecteur.
#4 Enseignements de la parabole
La grande majorité des commentateurs interprète cette parabole comme un avertissement contre l’amour de l’argent et un appel à une gestion prudente des biens. Cette interprétation est notamment soutenue par Jean Chrysostome (349-407), le Père de l’Église et l’archevêque de Constantinople.
Ainsi, les enseignements fondamentaux que l’on peut tirer de cette parabole se résument essentiellement aux points suivants :
Enseignement #1 : un avertissement contre les possessions
La richesse devient problématique lorsqu’elle est accumulée et utilisée exclusivement pour son plaisir personnel, ce qui peut indiquer un cœur non-repentant. L’homme riche est condamné, non pas en raison de sa richesse même, mais en raison de son égoïsme et de son indifférence envers la souffrance de Lazare.
Enseignement #2 : la bonne gestion des biens
Les chrétiens, riches comme pauvres, doivent garder à l’esprit que tout appartient au Créateur et qu’ils devront rendre des comptes sur la gestion des ressources qui leur auront été confiées ici-bas. Les biens doivent servir à l’avancée du Royaume, conformément aux commandements divins.
Enseignement #3 : la suffisance des Écritures
Dans la parabole, Abraham insiste sur le fait que les enseignements de Moïse et des prophètes (c’est-à-dire les Écritures) sont suffisants pour guider les personnes vers la repentance et la foi. Il est donc essentiel de prendre les Écritures au sérieux.
Enseignement #4 : la richesse n’est pas synonyme de bénédiction, ni la pauvreté de malédiction.
À travers cette parabole, Jésus démontre que la possession de richesses n’est pas un signe de la faveur divine, et que la pauvreté ne doit pas être interprétée comme une malédiction. Ce récit constitue une réfutation de la théologie de la prospérité, car Dieu était du côté de Lazare.

#5 Une interprétation alternative
Une autre interprétation suggère que la parabole est une critique des autorités juives, notamment Caïphe, qui pourrait être représenté par l’homme riche. Même si cette explication est moins répandue, davantage spéculative et ne supplante pas la première, elle mérite néanmoins d’être évoquée.
Du temps de Jésus, Caïphe était le grand-prêtre et appartenait au courant saducéen. Ce dernier, contrairement au pharisianisme, s’en tenait strictement au texte écrit de la Torah et rejetait les traditions orales, les anges, les démons, et la résurrection.
À peine avait-il dit cela, qu’il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l’assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu’il n’y a pas de résurrection, pas plus que d’ange ni d’esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela
Actes 23 : 8
Caïphe était également le président du Sanhédrin, l’assemblée législative et le tribunal suprême d’Israël, où Jésus fut jugé et condamné à mort.
Les arguments en faveur de l’idée que Caïphe était l’homme riche de la parabole sont les suivants :
Argument #1 : les habits de l’homme riche
Dans la parabole, il est mentionné que l’homme riche « s’habillait de pourpre et de fin lin », ce qui était non seulement un signe de richesse mais aussi caractéristique de l’habillement des prêtres.
Voici les vêtements qu’ils feront : un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu’ils rempliront la fonction de prêtres pour moi. Ils emploieront de l’or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du fin lin.
Exode 28 : 4-5
Argument #2 : Une simple porte ou l’entrée du temple ?
Un autre argument suggère que la « porte » où Lazare est déposé pourrait symboliquement représenter celle du temple. L’expression « devant son portail « utilise le même mot grec (πυλῶνα) que celui utilisé pour désigner l’entrée du temple dans certains passages du Nouveau Testament.
Par ailleurs, en plus de cette parabole, Luc mentionne également dans les Actes un homme malade qui était régulièrement déposé devant la porte du temple pour mendier, ce qui rappelle la situation de Lazare.
Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu’on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient dans le temple.
Actes 3: 2
Argument #3 : Caïphe avait 5 frères
Une raison supplémentaire en faveur de l’idée que l’homme riche de la parabole pourrait être Caïphe est que ce dernier avait cinq frères, tout comme l’homme riche mentionné dans la parabole.
En effet, l’historien juif Flavius Josèphe (37 à 100 après Jésus-Christ) mentionne qu’Hanne, un autre grand prêtre, avait cinq fils qui ont également été grands prêtres. Or Hanne était le beau-père de Caïphe.
Ils l’emmenèrent d’abord chez Hanne, beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette année-là.
Jean 18 : 13
Par ailleurs, le mot grec « ἀδελφούς », employé pour désigner les « frères » dans la parabole, peut aussi faire référence à d’autres types de liens familiaux, y compris celui des « beaux-frères ».
Argument #4 : les 5 frères ne croyaient pas à la résurrection.
À la fin de la parabole, le riche suggère que le retour d’un mort serait un signe suffisamment fort pour convaincre ses frères de changer de vie. Cependant, Abraham lui répond que cela ne suffira pas, car leur cœur est trop endurci.
Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.”
Luc 16 : 30-31
Ce scepticisme envers la résurrection correspond aux croyances traditionnelles des Sadducéens.
Étant donné l’affiliation de Caïphe à ce courant, il est plausible que ses cinq frères aient partagé ces convictions, surtout que Hanne, leur père, appartenait aussi à cette même mouvance.
Argument #5 : Caïphe rejette la résurrection d’un Lazare en Jean 11
Certains commentateurs suggèrent que cette parabole serait possiblement liée à la résurrection de Lazare, l’ami de Jésus, décrite dans Jean 11.
En effet, ce passage aborde des éléments similaires comme la résurrection d’un Lazare et la réaction sceptique de Caïphe, qui condamne Jésus au lieu de croire au miracle.
Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d’entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait.
Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le sanhédrin et dirent: «Qu’allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.»
L’un d’eux, Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là, leur dit: «Vous n’y comprenez rien; vous ne réfléchissez pas qu’il est dans notre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas.»
Jean 11 : 45-50
La résurrection de Lazare apparaît comme l’élément déclencheur menant à l’arrestation de Jésus, au point que le Sanhédrin a aussi envisagé de mettre fin à la vie de Lazare.
Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui.
Jean 12 : 10-11
Si cet argument est valide, la parabole sert alors de préfiguration sur les événements ultérieurs relatés dans l’Évangile selon Jean.
Argument #6 : Les pharisiens étaient dans l’audience
Même si la parabole n’indique pas clairement la présence des pharisiens dans l’auditoire, il est probable qu’ils y étaient. En effet, juste avant, aux versets 14 à 18, Jésus critique les Pharisiens pour leur cupidité, leur prétention à l’humilité, leur prétention et leur incompréhension de la loi, des motifs également présents dans la parabole.
Bien que les Sadducéens ne soient pas directement cités, leurs diverses alliances avec les Pharisiens pour piéger Jésus suggèrent que la critique visant Caïphe a dû également les affecter.
Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel.
Matthieu 16 : 1
#6 Conclusion
La parabole du riche et de Lazare met en garde contre l’amour de l’argent et souligne l’importance de gérer ses biens avec sagesse, en les mettant au service de l’Évangile et des plus démunis. Elle insiste par ailleurs sur la suffisance des Écritures et réfute l’idée que la prospérité matérielle est systématiquement un signe de bénédiction divine.
En fin de compte, cette parabole rappelle que l’attitude envers les richesses terrestres peut avoir des répercussions éternelles, et encourage le chrétien à placer ses priorités dans la construction du Royaume de Dieu plutôt que dans le confort matérialiste individuel.
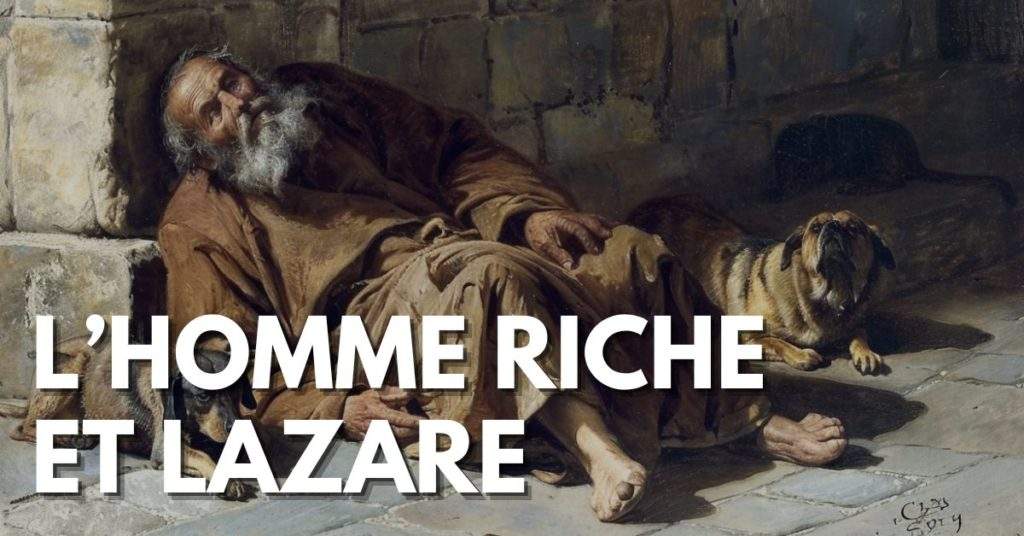
Ce blog a pour objectif de vous aider à améliorer vos finances personnelles à travers des principes bibliques et des enseignements financiers.
En vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez les nouveaux articles ainsi que du contenu exclusif sur votre boite mail !
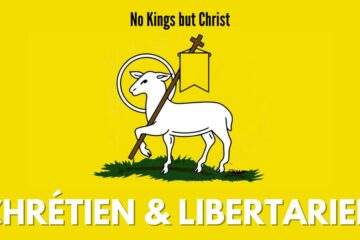
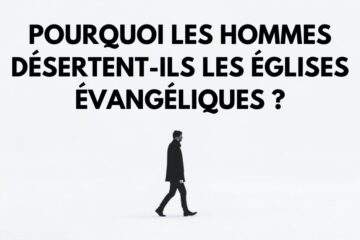

2 commentaires
KONG LEON · 08/05/2024 at 4:14 am
Je souhaiterais en savoir davantage concernant les finances.
Edouard Calvaire · 12/05/2024 at 10:11 pm
Je partage entièrement votre compréhension et votre enseignement sur cette fameuse parabole du riche et de Lazare. Mais l’autre alternative m’est tout à fait nouvelle. Que Dieu bénisse votre ministère !